Quels sont les six présages ? Ce sont : le vrai songe, le rêve prémonitoire, le rêve chargé de pensées, le rêve éveillé, le bon rêve, le rêve d'angoisse.
Le Vrai Classique du vide parfait, Lie-tseu.
Quels sont les six présages ? Ce sont : le vrai songe, le rêve prémonitoire, le rêve chargé de pensées, le rêve éveillé, le bon rêve, le rêve d'angoisse.
Le Vrai Classique du vide parfait, Lie-tseu.

À quoi cela ressemble-t-il d'être une chauve-souris ? Nagel suggère qu'avant de pouvoir répondre à une telle question, nous devons pouvoir ressentir la vie d'une chauve-souris à travers les modalités sensorielles d'une chauve-souris. Mais il a tort ; ou du moins il nous engage sur une fausse piste. Être une chauve-souris vivante consiste à être empli d'être. Être chauve-souris, dans le premier cas, être humain dans le second, peut-être; mais ce sont là des considérations secondaires. Être empli d'être, cela consiste à vivre comme un corps-âme. Un autre nom pour désigner cette expérience du plein-être est la joie.
"Être vivant c'est être une âme vivante. Un animal – et nous sommes tous des animaux – est une âme incarnée. C'est précisément ce que Descartes a vu et que, pour des raisons qui lui appartiennent, il a choisi de nier. Un animal vit, disait Descartes, de même qu'une machine vit. Un animal n'est rien que le mécanisme qui le constitue; s'il a une âme, c'est de la même façon qu'une machine a une pile, pour lui fournir l'étincelle qui la met en marche; mais l'animal n'est pas une âme incarnée, et la qualité de son être n'est pas la joie.
"Et puis il y a le fameux Cogito ergo sum. C'est une formule qui m'a toujours mise mal à l'aise. Elle implique qu'un être vivant qui ne fait pas ce que nous appelons penser est d'une façon ou d'une autre un être inférieur. À la pensée, à la cogitation, j'oppose la plénitude, le fait de s'incarner pleinement, la sensation d'être – non pas une conscience de soi comme une sorte de fantomatique machine à raisonner qui génère des pensées, mais au contraire la sensation – une sensation fortement affective – d'être un corps avec des membres qui se prolongent dans l'espace, bref d'être vivant au monde."
Sadrâ ne cache pas sa profonde affection à l'égard des animaux, le souci qu'il a de leur réserver un destin dans le cadre du retour à Dieu de toutes les créatures. Nous le voyons proposer une analyse remarquable de l'âme animale, qui est, aussi bien, l'âme des hommes quand ils n'exercent pas leur puissance intellective. Le vivant animal reste identique à soi, il possède une individualité permanente en tous ses états. En outre, les bêtes ont une certaine conscience d'elles-mêmes. Elles fuient ce qui leur cause du déplaisir, et elles recherchent ce qui leur procure du plaisir, elles fuient les douleurs dont elles savent qu'elles sont pour elles une douleur, ce qui implique une certaine connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes.L'Acte d'être : La Philosophie de la révélation chez Mollâ Sadrâ
Or, qui dit connaissance ('ilm) dit nécessairement séparation d'avec la matière. En effet, la connaissance que l'animal a de son propre soi est permanente, et elle n'est pas acquise par les sens. Il s'agit d'un savoir immédiat, qui n'a besoin ni d'une preuve par une certaine pensée réflexive, ni d'un témoignage des sens. Cette connaissance antéprédicative de soi, cette présence à soi et à son acte individuel d'exister, l'animal n'en est pas privé. Il témoigne ainsi de l'immétarialité de ce soi.
"Permettez-moi de vous raconter ce que les singes de Tenerife apprirent de leur maître Wolfgang Köhler, en particulier Sultan, le meilleur de ses élèves, dans un certain sens le prototype de Peter le Rouge.
"Sultan est seul dans sa cage. Il a faim : la nourriture qui arrivait d'habitude a soudain inexplicablement cessé de venir.
"L'homme qui d'habitude lui donnait à manger et qui a maintenant arrêté de le faire tend un fil au-dessus de la cage, à trois mètres au-dessus du sol, et y suspend un régime de bananes. Il traîne dans la cage trois caisses de bois. Ensuite il disparaît, fermant la porte derrière lui, même s'il est toujours dans les parages, puisqu'on sent son odeur.
"Sultan sait ce qu'il est censé faire : maintenant on est censé penser. Voilà ce dont il s'agit avec ces bananes placées là-haut. Les bananes sont là pour mener à penser, pour nous inciter à aller jusqu'au bout de l'acte de penser. Mais que doit-on penser ? On pense : Pourquoi m'affame-t-il ? On pense : Qu'ai-je fait ? Pourquoi ne m'aime-t-il plus ? On pense : Pourquoi ne veut-il plus de ces caisses ? Mais aucune de ces pensées n'est la bonne. Même avec une pensée plus compliquée – par exemple : Qu'est-ce qu'il a donc ? Quelle idée fausse se fait-il de moi pour croire qu'il m'est plus facile d'atteindre une banane accrochée à un fil de fer plutôt que de ramasser une banane par terre ? – il fait encore fausse route. La pensée juste est : Comment utiliser ces caisses pour atteindre les bananes.
"Sultan traîne les caisses au-dessous des bananes, les empile les unes sur les autres, escalade l'échafaudage qu'il vient de bâtir et s'empare des bananes. Il pense : Maintenant va-t-il cesser de me punir ?
"La réponse est : Non. Le lendemain l'homme suspend un régime frais de banane au fil de fer, mais il remplit aussi les caisses de pierres, si bien qu'elles sont trop lourdes pour qu'on les traîne. On n'est pas censé penser : Pourquoi a-t-il rempli les caisses de pierres ? On est censé penser : Comment va-t-on utiliser les caisses pour se saisir des bananes en dépit du fait qu'elles sont remplies de pierres ?
"On commence à voir comment fonctionne l'esprit de l'homme.
"Sultan vide les caisses de leurs pierres, bâtit un échafaudage à l'aide des caisses, escalade l'échafaudage, s'empare des bananes.
"Aussi longtemps que Sultan continue de penser faux, on l'affame. On l'affame jusqu'à ce que les tiraillements d'estomac deviennent si intenses, si incoercibles qu'il est forcé de penser juste, à savoir, comment faire pour s'emparer des bananes. Et c'est ainsi que les capacités mentales du chimpanzé sont testés jusqu'à leur extrême limite.
"L'homme laisse tomber un régime de bananes à un mètre de la cage toujours équipée du fil de fer. À l'intérieur, il jette un bâton. La pensée fausse est : Pourquoi a-t-il arrêté de suspendre les bananes au fil ? La pensée fausse (la pensée fausse correcte, toute fois) est : Comment utiliser le bâton pour atteindre les bananes ?
"À chaque étape, Sultan est poussé à penser la pensée la moins intéressante. Il est impitoyablement écarté de la pureté de la spéculation (Pourquoi les hommes se comportent-ils de la sorte ?) et poussé vers une forme de raison plus basse, pratique et instrumentale (Comment utilise-t-on ceci pour obtenir cela ?), et donc vers une acceptation de soi comme un organisme primordialement doté d'un appétit qui doit être satisfait. Bien que toute son histoire, depuis le moment où sa mère fut tuée et qu'il fut capturé, en passant par son voyage dans une cage, jusqu'à son emprisonnement dans ce camp de prisonniers sur cette île et aux jeux auxquels on se livre à propos de la nourriture, le mène à se poser des questions sur la justice de l'univers et sur la place qu'y occupe cette colonie pénitentiaire, un régime psychologiquement soigneusement élaboré le détourne de l'éthique et de la métaphysique vers les plus humbles niveaux de la raison pratique. Et, tandis qu'il progresse tant bien que mal dans ce dédale de contraintes, de manipulations et de mensonges, il doit se rendre compte qu'il ne saurait en aucun cas abandonner la partie, car sur ses épaules repose la responsabilité de représenter la gent simienne. Il se peut que le sort de ses frères et sœurs soit déterminé par la qualité de sa performance.
"Wolfgang Köhler était probablement un brave homme. Un brave homme, mais non pas un poète. Un poète aurait tiré quelque chose de l'instant où les chimpanzés tournent en rond dans leur enclos, exactement comme une fanfare militaire, certains aussi nus que le jour où ils sont nés, certains drapés de toile ou de vieux lambeaux de tissu qu'ils ont ramassés ici ou là, certains portant des morceaux de détritus."
J.M. Coetzee, Elizabeth Costello : Huit leçons de J-M Coetzee,Catherine Lauga du Plessis (Traduction) ( 6 avril 2006 )
Toutes les capitales européennes m'ont fasciné : elles sont les visages de pierre de l'Histoire. Londres, Prague, Paris, Rome, Athènes, Bucarest, Sofia, Madrid... Toutes, sans exception. Errer dans la littérature, c'est errer également dans les capitales et les grandes villes : le Paris de Balzac, de Hugo ou de Baudelaire, le Londres de Dickens, le Dublin de Joyce, la Rome de du Bellay, la Florence de Dante, la Venise de Thomas Mann, le Berlin de Döblin... Mais l'image la plus frappante de notre rapport aux villes, à nous Européens, je l'ai vue dans un film de Fellini, Roma, dans lequel des ouvriers creusant un couloir pour le métro découvrent soudain une galerie décorée des fresques antiques. Alors qu'ils contemplent, stupéfaits, les formes muettes aux gestes suspendus, sacralisées par le temps impalpable, l'oxygène s'engouffrant dans la cavité efface lentement les peintures, qui se dissolvent dans l'abîme dévorant de l'Histoire. Cette scène m'est restée pour toujours, par sa décomposition tragique, mais aussi par ce qu'elle faisait apparaître de nos capitales, sédimentées par le temps, accumulant plusieurs niveaux historiques, comme la ville de Troie superposait sept niveaux de ruines. Prague, le soir, dans les rues baroques illuminées, est un théâtre du XVIIº siècle qui n'attend qu'un carrosse et un bal masqué en longues traînes. En Italie, la plupart des villes s'enroulent dans le passé : Venise est un palais surgi de l'eau sur lequel défilent les licornes, les masques et les lentes génuflexions du carnaval, comme si le temps lui-même se diluait dans un rêve de soi. Entrer dans Rome, c'est entrer dans le bric-à-brac des époques, le désordre de kaléidoscope de la ville la plus riche qui soit, au point de laisser à l'abandon ses grands palais déserts, ses monuments en ruine, l'Histoire ployant à chaque coin de rue, ouvrant là le Ier siècle, là la Renaissance, là le baroque, puis s'échappant vers le XIXº et le XXº siècle, car Rome est la somme de tous les temps. J'ai employé des journées entières à me promener dans Paris et à sentir le poids du passé dans cette perfection géométrique qui est attaché à notre pays. Pas le désordre des siècles romains mais la netteté esthétique de notre classicisme, troué par des flèches fantastiques érigées dans le ciel, comme des envolées sombres du Moyen-Âge ou des gibets du mystère. J'ai rêvé sur les gargouilles de Notre-Dame, je suis passé sombre et silencieux sous la tour Saint-Jacques, j'ai été éberlué par des noms mirifiques, au mur des immeubles dans lesquels ils avaient vécu : Rousseau, Diderot, Hugo, Balzac, Verlaine, Baudelaire ou Rimbaud... Chacune de ces villes montre l'emprise de l'Histoire sur notre continent – œuvre multiple du peuple européen, peuple barbare poli par les siècles, ravagé en permanence par les guerres, les invasions, et toujours renaissant : l'enfer de Dante et le paradis. En même temps.
Berlin, ville détruite en 1945, n'est pas parée de ces prestiges immémoriaux. Elle est neuve. Mais sa nouveauté s'est mise à penser l'Histoire. C'est pour cela que Berlin est un concept. Alors que les autres villes sont l'Histoire, Berlin, qui n'a plus d'Histoire, la pense, la montre, la dévoile. Mais cette Histoire, ce n'est pas l'Antiquité ou le Moyen-Âge, c'est celle de la deuxième moitié du XXº siècle. Berlin pense la chute du continent européen. Berlin est notre cicatrice exposée au monde.
L'Origine de la violence, Fabrice Humbert.
Son attitude face à la vie était d'ailleurs celle de beaucoup de bâtards. Tandis que certains manifestent une volonté de reconnaissance exacerbée, tentant de se forger une place dans le monde pour y laisser une marque, d'autres se réfugient dans leur monde intérieur, où ils fabriquent un univers. Parce qu'ils se sentent étrangers dans leur propre famille, invités, tolérés même, ils se sentent aussi invités dans le monde extérieur. L'attitude de chat aux pattes de velours qu'ils ont adoptée dans leur enfance, glissant de pièce en pièce, sans trop se faire remarquer de ces êtres à la fois familiers et étrangers qui les entourent, ils l'adoptent ensuite dans leur vie, glissant de lieu en lieu, de décennie en décennie, comme une ombre.
Fabrice Humbert, L'Origine de la violence.
...Oh ta merveilleuse compréhension de moi
Hauteur
que je n'atteindrai jamais
Où aller loin de ton souffle ?
Où partir
loin de ta face ?
Si je monte au ciel tu es là
Si je m'étends chez les morts
tu es déjà là
Je prends les ailes de l'aurore
Je me pose à l'extrémité des mers
Même là c'est ta main qui m'emmène
Ta poigne
me tient
Si je dis oh les ombres m'emportent
Même la nuit
c'est la lumière autour de moi
Pour toi les ombres n'ont pas d'ombres
La nuit éclaire comme le jour
Comme l'ombre
comme la lumière
C'est toi qui as fabriqué mes reins
Tu m'as tissé
au cœur de ma mère
Merci je suis merveilleux
et de manière très étonnante...
Psaume 139 (138) 6-14. trad. O. Cadiot, M. Sevin.
Nous ne lisons, apparemment, que parce que l'écrit est déjà là, se disposant sous notre regard. Apparemment. Mais celui qui écrivit en premier, entaillant sous les cieux anciens la pierre et le bois, loin de répondre à l'exigence d'une vue demandant repère et lui donnant un sens, changea tous les rapports entre voir et visible. Ce qu'il laissait après lui, ce n'était pas quelque chose de plus, s'ajoutant aux choses; ce n'était même pas quelque chose de moins – une soustraction de matière, un creux par rapport au relief. Qu'était-ce donc ? Un vide d'univers : rien qui fût visible, rien qui fût invisible. Je suppose qu'en cette absence non absente le premier lecteur sombra, mais sans en rien savoir, et il n'y eut pas de second lecteur, puisque la lecture, entendue dès lors comme la vision d'une présence immédiatement visible, c'est-à-dire intelligible, fut précisément affirmée pour rendre impossible cette disparition dans l'absence de livre.
Maurice Blanchot, L'Entretien infini
Tout commence un jour d'octobre 1943 dans l'angoisse, la solitude et la honte de l'occupation de la France par les nazis. On se trouve, tout à coup, ajusté à une étrange constatation verticale, sans contenu, sans dimension, dont on était toujours accompagné et qui soudain, se détachent avec une netteté et une intensité toute particulière. C'est une simple certitude d'être, une surrection originelle par laquelle on tombe véritablement en soi. C'est une commotion, un établissement, une fulguration dont naît l'assise qui sera invariable tout au long de la vie. En même temps, on entend le chant du foehn, de vent du Sud, qui traverse la montagne et paraît soulever la maison, la rehausser, la faire se dresser comme serrée par toute l'immensité qui se déploie autour.
Les Maximes resserraient le ventre, c'était pointu et alerte, à travers elles la langue française m'apparaissait, vive, rapide, nette. Cette façon qu'elle avait d'aller droit au but, cette minceur du français faisaient dans le corps un étrange effet acéré et presque gai.
Ces gros hommes placides et pacifiques qui sortaient leurs tourniquets de cartes postales sur le trottoir ou mettaient leurs lots de shampoing dans la vitrine, les voilà soudain en uniformes caca d'oie, la bouche tordue par la haine, et défilant au pas de l'oie.
À dix ans, comme tout enfant allemand, j'étais en pleine possession de la langue puisque tout, en elle, est fait de ses propres éléments. On en est pénétré au plus intime de soi. Les bruits, les couleurs, les consistances, tout s'apprend dans l'émerveillement de la langue maternelle, la maison, le jardin ou l'école forment les sédiments de l'être-soi. La langue, c'est le train qui passe dans le lointain, haut sur roues, ce sont les reflets de l'eau sous la voûte du pont, ce sont les voix qui appellent, le Rascheln des feuilles mortes dont le pied retourne l'épaisseur.
Parfois, lorsque la directrice de l'internat cherchait sur l'écran Radio Londres pour écouter le général de Gaulle, dont je savais qu'il était la France, et les messages amicaux destinés à la Résistance, il m'était arrivé d'entendre des voix allemandes, mais elles étaient toujours hostiles, tranchantes, aigres, criardes et méchantes, la haine et la bassesse parlaient dans les timbres des affidés et serviteurs de la tyrannie et de la mort.
En vain, tentais-je de capter ce chant de la langue et des voix de mon enfance d'avant l'exil : la voix des vieilles dames à ruban de velours autour du cou qui détachaient les syllabes, laissaient filer les sonorités sans trop appuyer, et qui donnaient à l'allemand une douceur, un velouté si particuliers. Cet allemand qui sait éviter les sons rugueux, gutturaux ou rapeux et donne aux mots qu'on prononce vigueur et souplesse, cet allemand libre en somme, n,avait plus droit de cité, il avait été anéanti par le parler nazi en LTI (lingua tertii imperii, la langue du IIIº Reich).
L'allemand s'était jadis édifié sur la traduction de la Bible par Luther en 1535. Luther avait créé un idiome juteux, sonore et évocateur, plein d'images, un mélange de douceur et de violence, à nul autre pareil. Il s'était fait a langue selon ses besoins, il avait pris dans les divers parlers régionaux ce qui en ferait la justesse et la vigueur. Mais les hitlériens, en l'utilisant à contresens, pour fabriquer leurs combinaisons verbales criminelles,avaient fait de cette langue l'instrument de l'extermination.
Je fus tout de même quelque peu flatté de traduire des textes destinés au concours le plus difficile de France et de constater que la difficulté n'était qu'apparente, une fois traduite, la ligne de pensée en était toujours simplette et naïve.
Cette langue allemande-là qu'on me présentait ainsi, tassée et chantournée, je la trouvais ridicule. Dans la plupart des phrases on abusait des facilités de l'allemand à faire traîner les choses, grâce aux particularités de sa grammaire.
Tout y était retardé, différé sans cesse, c'était confus et opaque et cela laissait le lecteur indifférent et respectueux. Ce n'était en rien ma langue, et pourtant je ne rencontrais aucune difficulté à traduire ces gros paquets de sens sommaire. Rien n'habitait tout ce qu'écrivaient ces Herbert Cysarz ou Ernst Bertram ou Hans Carossa et autres Ernst Jünger, gonflés, granitiques et cartonneux ou sirupeux et douceâtres, dont je ne m'étonnais pas d'apprendre plus tard qu'ils furent tous nazis avec enthousiasme, ce que mon professeur d'allemand ignorait autant que moi, même si leur pesante solennité aurait dû la mettre sur la voie. Ce qu'ils écrivaient était caillouteux et haché, faits de morceaux accolés. On y entendait une rumeur farouche, c'était armé de pied en cap et ne faisait grâce de rien ; c'était à la fois alambiqué et plein de componction et, en fait, cela répétait sans le dire, à longueur de lignes : am deutschen Wesen soll die Welt genesen, l'être allemand guérira le monde !
C'était une langue enflée et prétentieuse que personne ne parlait, une langue sans oralité, sans rythme. Elle n'avait rien de commun avec celle que j'aimais et qu'avaient parlée mes parents et mes camarades d'école.
Mes parents, surtout, nés au XIXº siècle et déjà adultes à l'orée du XXº siècle, parlaient un allemand plein de charme et d'images, un allemand qui tombait juste, plein d'expressions pittoresques, celui de la conversation courante.
Le Poing dans la bouche, Georges-Arthur Goldschmidt .

En rédigeant Une Saison et l'"Adieu" qui la termine, si Rimbaud met fin à ses rapports avec la littérature, cela ne veut pas dire qu'au mois d'août 1873, à tel jour et à telle heure, il s'est levé et retiré. Une décision d'ordre moral peut à la rigueur n'avoir besoin que d'un instant pour s'accomplir : telle est sa force abstraite. Mais la fin de la littérature est à nouveau toute la littérature, puisqu'elle doit trouver en elle-même sa nécessité et sa mesure. Admettons, comme il est possible et, je pense, probable, que Rimbaud ait continué à faire œuvre poétique, après avoir enterré son imagination et ses souvenirs : que signifierait cette activité continuée et cette survie ? Ceci d'abord, que sa rupture n'a pas été seulement un "devoir", comme il a pu le penser momentanément, mais a répondu à une exigence plus obscure, plus profonde et, en tout cas, moins déterminée. Ensuite, qu'à celui qui veut enterrer sa mémoire et ses dons, c'est encore la littérature qui s'offre comme terre et comme oubli.
Maurice Blanchot, L'Entretien infini


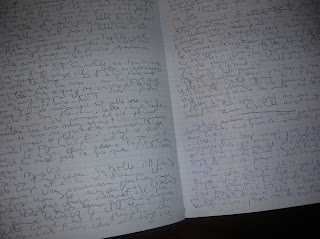
C'est dans une maison qu'on est seul.
Mon écriture, je l'ai toujours emmenée avec moi, où que j'aille.
Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres.
Écrire, c'était ça la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait.
On ne trouve pas la solitude, on la fait.
Du moment qu'on est perdu et qu'on n'a donc plus rien à écrire, à perdre, on écrit. Tandis que le livre il est là et qu'il crie et qu'il exige d'être terminé, on écrit. On est obligé de se mettre à son rang. C'est impossible de jeter un livre pour toujours avant qu'il ne soit tout à fait écrit – c'est-à-dire : seul et libre de vous qui l'avez écrit. C'est aussi insupportable qu'un crime. Je ne crois pas les gens qui disent : "J'ai déchiré mon manuscrit, j'ai tout jeté." Je n'y crois pas. Ou bien ça n'existait pas pour les autres, ce qui était écrit, ou bien ce n'était pas un livre. Et quand ce n'est pas un livre, on le sait toujours. Quand ce ne sera jamais un livre, non, on ne le sait pas. Jamais.
On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture, il faut être plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose, oui. C'est pas seulement l'écriture, l'écrit, c'est les cris des bêtes de la nuit, ceux de tous, ceux de vous et de moi, ceux des chiens. C'est la vulgarité massive, désespérante, de la société.
Certains écrivains sont épouvantés. Ils ont peur d'écrire. Ce qui a joué dans mon cas, c'est peut-être que je n'ai jamais eu peur de cette peur-là.
L'écrit ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit, et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie.

Maurice Blanchot, L'Entretien infiniIl se peut, comme on aime à le déclarer, que "l'homme passe". Il passe. Il a même toujours déjà passé, dans la mesure où il a toujours été approprié à sa propre disparition. Mais, passant, il crie; il crie dans la rue, dans le désert; il crie mourant; il ne crie pas, il est le murmure du cri. Il n'y a donc pas à renier l'humanisme, à condition de le reconnaître là où il reçoit son mode le moins trompeur : jamais dans les zones de l'autorité, du pouvoir et de la loi, de la culture et de la magnificence héroïque et pas davantage dans le lyrisme de bonne compagnie, mais tel qu'il fut porté jusqu'au spasme du cri : entre autres, par celui qui, refusant de parler de soi comme un homme, évoquait seulement la bête mentale et dont on peut bien cependant se permettre de dire qu'il a été "humaniste par excellence", étant sans humanité et presque sans langage, "car, en effet, je m'étais rendu compte que c'était assez de mots, assez même de rugissements et que ce qu'il fallait, c'étaient des bombes et que je n'en avais pas dans les mains, ni dans les poches." Et le même, par le même mouvement, fut tel qu'il ne vécut jamais que pour affirmer "une haute mesure d'équité sans secret"; ce qui est aussi l'attente sans espoir qui se brise dans le cri "humaniste'.
"Pourquoi ce nom ? Et est-ce bien un nom ?
– Ce serait une figure ?
– Alors une figure qui ne figure que ce nom.
– Et pourquoi un seul parlant, une seule parole ne peuvent-ils, jamais réussir, malgré l'apparence, à le nommer ? Il faut être au moins deux pour le dire.
– Je le sais. Il faut que nous soyons deux.
– Mais pourquoi deux ? Pourquoi deux paroles pour dire une même chose ?
– C'est que celui qui la dit, c'est toujours l'autre."
Le quotidien est humain. La terre, la mer, la forêt, la lumière, la nuit ne représentent pas la quotidienneté, laquelle appartient en premier lieu à la dense présence des grandes agglomérations urbaines. Il faut ces admirables déserts que sont les villes mondiales pour que l'expérience du quoditien commence à nous atteindre. Le quotidien n'est pas au chaud dans nos demeures, il n'est pas dans les bureaux ni dans les églises, pas davantage dans les bibliothèques ou les musées. Il est – s'il est, quelque part – dans la rue.
Il ne faut pas douter de l'essence dangereuse du quotidien, ni de ce malaise qui nous en saisit, chaque fois que, par un saut imprévisible, nous nous en écartons et, nous tenant en face de lui, découvrons que rien précisément ne nous fait face : "Comment ? C'est cela, ma vie quotidienne ?" Non seulement, il n'en faut pas douter, mais il ne faut pas la redouter, il faudrait bien plutôt chercher à ressaisir la secrète capacité destructrice qui est là en jeu, la force corrosive de l'anonymat humain, l'usure infinie. Le héros, pourtant homme de courage, est celui qui a peur du quotidien et qui en a peur, non pas parce qu'il craint d'y avoir trop à son aise, mais parce qu'il redoute d'y rencontrer le plus redoutable : une puissance de dissolution. Le quotidien récuse les valeurs héroïques, mais c'est qu'il récuse bien davantage, toutes les valeurs et l'idée même de valeur, ruinant toujours à nouveau la différence abusive entre authenticité et inauthenticité. L'indifférence journalière se situe à un niveau où la question de valeur ne se pose pas : il y a du quotidien (sans sujet, sans objet), et tandis qu'il y en a, le "il" quotidien n'a pas à valoir et, si la valeur prétend cependant intervenir, alors "il" ne vaut "rien" et "rien" ne vaut à son contact. Faire l'expérience de la quotidienneté, c'est se mettre à l'épreuve du nihilisme radical qui est comme son essence et par lequel, dans le vide qui l'anime, elle ne cesse de détenir le principe de sa propre critique.
Maurice Blanchot, L'Entretien infini
Naître, c'est, après avoir eu toutes choses, manquer soudain de toutes choses, et d'abord de l'être, – si l'enfant n'existe ni comme corps constitué, ni comme monde. Tout lui est extérieur, et il n'est presque rien que cet extérieur : le dehors, l'extériorité radicale sans unité, la dispersion sans rien qui se disperse; l'absence qui n'est absence de rien est d'abord la seule présence de l'enfant, mais ce manque, c'est l'"inconscient" : la négation qui n'est pas seulement défaut, mais rapport à ce qui fait défaut – désir. Désir dont l'essence est d'être éternellement désir, désir de ce qu'il est impossible d'atteindre et même de désirer.
Maurice Blanchot, L'Entretien infini


L'homme tout à fait malheureux, l'homme réduit par l'abjection, la faim, la maladie, la peur, devient ce qu'il n'a plus de rapport avec soi, ni avec qui que ce soit, une neutralité vide, un fantôme errant dans un espace où il n'arrive rien, un vivant tombé au-dessous des besoins. Ce malheur peut être particulier, mais il concerne surtout le grand nombre. Qui a faim pour soi seul et vit dans le dénuement de l'injustice, au milieu d'un monde encore heureux et tranquille, a une chance d'être renvoyé à une solitude violente, à ces sentiments qu'on appelle mauvais, envie, honte, désir de se venger, de tuer, de se tuer, où il y a encore de l'espoir. La faim dont nous parle Knut Hamsun est une faim que l'orgueil peut nourrir. Il semble que l'infini du nombre soit la vérité de cette autre sorte de malheur, mais il y a un point où ce qui est souffert ensemble, ne rapproche pas, n'isole pas, ne fait que répéter le mouvement d'un malheur anonyme, qui ne vous appartient pas, et ne vous fait pas appartenir à un espoir, mais c'est une dissemblance infinie, une oscillation sans niveau, une égalité sans rien d'égal. Et il n'est pas sûr qu'il soit nécessaire, pour s'approcher d'une telle situation, de recourir à ces exemples bouleversants et si vastes qu'a produits notre temps. Il est une fatigue dont on ne peut se reposer, qui consiste en ceci que l'on ne peut plus interrompre ce qu'on fait, travaillant toujours plus et, en somme, à la satisfaction générale : on ne peut plus être fatigué, se séparer de sa fatigue pour la dominer, la déposer et atteindre le repos. Ainsi la misère : le malheur. Il devient invisible et comme oublié. Il disparaît en celui qu'il a fait disparaître (sans porter atteinte à son existence), intolérable, mais toujours supporté, parce que celui qui le supporte n'est plus là pour l'éprouver en première personne.
L'homme souffrant et l'homme malheureux ou soumis à la misère sont devenus étrangers aux rapports maître-esclave qui constituent, au regard de leur situation, un statut presque prometteur. L'esclave a cette chance d'avoir un maître; le maître est aujourd'hui ce qu'il sert, il sera demain ce contre quoi il pourra se dresser. Il y a des esclaves sans maître, dont l'esclavage est tel qu'ils ont perdu tout maître, tout rapport avec le maître, tout espoir donc d'affranchissement, comme toute possibilité de révolte. Quand le maître est perdu, parce qu'il est devenu sans nom, un pur pouvoir irresponsable, introuvable, c'est déjà une situation extrêmement difficile, mais les puissances abstraites peuvent encore être nommées, le plus lointain et le plus insaisissable s'appelle un jour Dieu et la toute-puissance de Dieu finit par offrir prise à un combat décisif. Bien plus grave est l'esclavage qui est l'absence de l'esclave, la servitude des ombres, elle-même apparemment aussi légère qu'une ombre, là où le destin est sans poids et sans réalité. "Je me révolte, donc nous sommes", a dit Albert Camus dans une parole où il a mis toute la décision d'un espoir solidaire. Mais celui qui a perdu le pouvoir de dire "Je" est exclu de cette parole et de cet espoir.
Maurice Blanchot, L'Entretien infini: L'expérience-limite.

La torture est le recours à la violence – toujours sous l'espèce de la technique – en vue de faire parler; la violence, perfectionnée ou camouflée en technique, veut qu'on parle, veut une parole; quelle parole ? Non pas cette parole de violence – non parlante, fausse de part en part – que logiquement elle peut seulement espérer obtenir, mais une parole vraie, libre et pure de toute violence. Cette contradiction nous offense, mais aussi elle nous inquiète, parce que, dans cette égalité qu'elle établit et ce contact qu'elle rétablit entre violence et parole, elle ranime et provoque cette terrible violence qui est l'intimité silencieuse de toute parole parlante, et ainsi elle remet en cause la vérité de notre langage entendu comme dialogue et du dialogue entendu comme l'espace de la puissance exercée sans violence et luttant contre la puissance. (La formule : "Nous allons le mettre à la raison", que l'on trouve dans la bouche de tout maître de violence, éclaire bien cette complicité que la torture a pour idéal d'affirmer entre la raison et elle-même).
Maurice Blanchot, L'Entretien infini
(En aparté, on dirait Benito 16 qui parle de la foi en dégommant Luther au passage) :
... l'acte de la présence, le vrai lieu, là où se rassemble en une unité indivisée ce qui "est" : cette feuille cassée de lierre, cette pierre nue, un pas dispersé dans la nuit.
Le mauvais espoir est celui qui passe par l'idéal – le ciel de l'idée, la beauté des noms, le salut abstrait du concept. L'espoir est espoir vrai en ce qu'il prétend nous donner, dans l'avenir d'une promesse, ce qui est. Ce qui est est la présence. Mais l'espoir n'est qu'espoir. Il y a l'espoir, s'il se rapporte, loin de toute saisie présente, de possession immédiate, à ce qui est toujours à venir, et peut-être ne viendra jamais, et l'espoir dit la venue espérée de ce qui n'est encore qu'en espoir. Plus lointain ou plus difficile est l'objet de l'espoir, plus l'espoir qui l'affirme est profond et proche de sa destinée d'espoir : j'ai peu à espérer, quand ce que j'espère est presque sous la main. L'espoir dit la possibilité de ce qui échappe au possible; il est, à la limite, le rapport ressaisi là où le rapport est perdu. L'espoir est le plus profond lorsque lui-même se retire et de destitue de tout espoir manifeste. Mais, en même temps, il ne faut pas que nous espérions, comme en rêve, une fiction chimérique : c'est contre cela que se désigne le nouvel espoir. Espérant, non le probable qui n'est pas la mesure de ce qu'il y a à espérer, non la fiction de l'irréel, l'espoir vrai – l'inespéré de tout espoir – est l'affirmation de l'improbable et l'attente de ce qui est.
À la première page de son livre, l'une des plus belles, Yves Bonnefoy a écrit : "Je dédie ce livre à l'improbable, c'est-à-dire à ce qui est. À un esprit de veille. Aux théologies négatives. À une poésie désirée, de pluie, d'attente et de vent. À un grand réalisme, qui aggrave au lieu de résoudre, qui désigne l'obscur, qui tienne les clartés pour nuées toujours déchirables. Qui ait souci d'une haute et impraticable clarté."

– Je voudrais savoir ce que vous cherchez.
– Je voudrais le savoir aussi.
– Cette ignorance n'est-elle pas désinvolte ?
– Je crains qu'elle ne soit présomptueuse. Nous sommes toujours prêts à nous croire destinés à ce que nous cherchons, par un rapport plus intime, plus important que le savoir. Le savoir efface celui qui sait. La passion désintéressée, la modestie, l'invisibilité, voilà ce que nous risquons de perdre en ne cherchant pas seulement.
Le retour efface le départ, l'erreur est sans chemin, elle est cette force aride qui déracine le paysage, dévaste le désert, abîme le lieu.
L'erreur essentielle est sans rapport avec le vrai qui est sans pouvoir sur elle. La vérité dissiperait l'erreur, si elle la rencontrait. Mais il y a comme une erreur qui ruine par avance tout pouvoir de rencontre. C'est probablement cela, errer : aller hors de la rencontre.
– Voir, c'est donc saisir immédiatement à distance.Maurice Blanchot, L'Entretien infini
– ... immédiatement à distance et par la distance. Voir, c'est se servir de la séparation, non pas comme médiatrice, mais comme un moyen d'immédiation, comme im-médiatrice. En ce sens aussi, voir, c'est faire l'expérience du continu, et célébrer le soleil, c'est-à-dire, par-delà le soleil : l'Un.
– Pourtant, nous ne voyons pas tout.
– C'est la sagesse de la vue, encore que nous ne voyions jamais seulement une chose, ni même deux ou plusieurs, mais un ensemble : toute vue est vue d'ensemble. Il reste que la vue nous retient dans les limites d'un horizon. La perception est la sagesse enracinée dans le sol, dressée vers l'ouverture : elle est paysanne au sens propre, fichée en terre et formant lien entre la borne immobile et l'horizon apparemment sans borne – pacte sûr d'où vient la paix. La parole est guerre et folie au regard. La terrible parole passe outre à toute limite et même à l'illimité du tout : elle prend la chose par où celle-ci ne se prend pas, ne se voit pas, ne se verra jamais; elle transgresse les lois, s'affranchit de l'orientation, elle désoriente.
Je cherche, sans y arriver, à dire qu'il y a une parole où les choses ne se cachent pas, ne se montrant pas. Ni voilées ni dévoilées : c'est là leur non-vérité.
– Il y aurait une parole par où les choses seraient dites, sans, du fait de ce dire, venir au jour ?
– Sans se lever dans le lieu où il y a toujours lieu d'apparaître ou, à défaut, de se refuser à l'apparence. Une parole telle que parler, ce ne serait plus dévoiler par la lumière. Ce qui n,implique pas qu'on voudrait rechercher le bonheur, l'horreur de l'absence de jour : tout au contraire, atteindre un mode de "manifestation", mais qui ne serait pas celui du dévoilement-voilement. Ici, ce qui se révèle ne se livre pas à la vue, tout en ne se réfugiant pas dans la simple invisibilité.
Lorsque nous fuyons, nous ne fuyons pas chaque chose, prise une à une et l'une après l'autre, dans la perspective d'une énumération régulière et indéfinie. Chaque chose, également suspecte, s'étant effondrée dans son identité de chose, et l'ensemble des choses s'effondrant dans le glissement qui les dérobe comme ensemble, la fuite fait alors se dresser chaque chose comme si elle était toute chose, et l'ensemble des choses, non pas comme l'ordre sûr où l'on pourrait s'abriter, ni même comme l'ordre hostile contre lequel il faut lutter, mais comme le mouvement qui dérobe et se dérobe. La fuite ne révèle donc pas seulement la réalité comme ce tout (totalité sans lacune, sans issue) qu'il faut fuir : la fuite est ce tout même qui se dérobe et où elle nous attire en nous repoussant. La fuite panique est ce mouvement de dérober qui se réalise comme la profondeur, c'est-à-dire comme ensemble qui se dérobe et à partir de quoi il n'y a plus de lieu pour se dérober. Ainsi la fuite s'accomplit-elle finalement comme impossibilité de fuir. C'est le mouvement de Phèdre :
Le ciel, tout l'univers est plein de mes aïeux.
Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale!
Mais que dis-je ? Mon père y tient l'urne fatale.
La fuite est l'engendrement de l'espace sans refuge. Fuyons – cela devrait dire : cherchons un refuge; mais cela dit : fuyons dans ce qu'il faut fuir, réfugions-nous dans la fuite qui retire tout refuge. Ou encore : là où je fuis, "je" ne fuis pas, la fuite seulement fuit, mouvement infini qui se dérobe, se dérobe et le laisse rien où l'on puisse se dérober.

Toute question renverrait à quelqu'un qui questionne, c'est-à-dire à cet être que nous sommes et qui seul a la possibilité de questionner ou encore de venir en question. Un être comme Dieu (par exemple) ne pourrait se mettre en question, il ne questionnerait pas; la parole de Dieu a besoin de l'homme pour devenir question de l'homme. Quand Jahveh demande à Adam après la faute : '"Où es-tu ?", cette question signifie que l'homme désormais ne peut plus être trouvé ni situé que dans le lieu de la question. L'homme est dès lors question pour Dieu même, qui ne questionne pas.
Dans la vie on prend toujours le mauvais chemin au bon moment. Dany Laferrière.