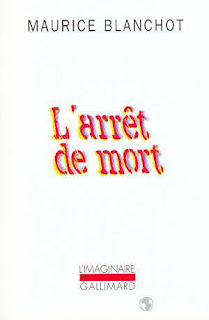Comment vas-Tu T'occuper de l'univers ?
Un Bektashi arrive dans la ville pour faire ses courses et cherche un endroit sûr pour y laisser son âne. Il fait le tour de la ville : l'endroit le plus sûr se trouve devant la mosquée. "Mon Dieu, je le confie à Toi, dit-il tout en attachant son âne, car tu sais qu'il est précieux pour moi." Ensuite, l'esprit tranquille, il va faire ses courses. Au retour, il ne trouve plus l'âne à sa place. Tu n'es même pas capable de garder l'âne que je Te confie, comment vas-Tu T'occuper de l'univers ?"
On ne peut espérer mieux pour une oeuvre accomplie en six jours
Quelqu'un pose cette question à un Bektashi : "Pourquoi ce monde n'est-il pas tout plat ? Il y a des montées et des descentes, des montagnes caillouteuses et des terres fertiles, des rocs qui entravent le chemin des hommes. Dans certains lieux il neige, dans d'autres sévit la sécheresse ; d'autres encore sont couverts de gazon. Pourquoi tout n'est-il pas étal dans ce monde ?"
Le Bektashi répondit : "On ne peut espérer mieux d'une oeuvre accomplie en six jours dans la précipitation."
Mon préféré :
Vous Le flattez trop
Il fait très chaud. Assoiffé, un Bektashi décide d'acheter une pastèque avec les quelques sous qu'il a en poche. La pastèque à la main, il trouve une belle ombre sous un arbre et coupe avec appétit sa pastèque. Mais, portant le premier morceau à la bouche, il la trouve tellement aigre qu'elle est difficilement mangeable. Il se met à crier des insultes : "Mais mon Dieu, pourquoi as-Tu été si radin que tu n'as pas mis quelques gouttes de sucre dans cette pastèque. Tu fais des faveurs à Tes serviteurs, mais ce n'est jamais comme il fait."
Bref, maugréant ainsi, comme il vient de dépenser ses derniers sous pour elle, il la finit pamgré son amertume et laisse son écorce à ses côtés. Allongé sous ce même arbre à moitié endormi, il voit un pauvre homme s'approcher. Celui-ci, également affamé et assoiffé, aperçoit l'écorce de pastèque et commence à la manger. Discrètement, le Bektashi l'observe, en faisant mine de dormir. Il voit avec étonnement que le pauvre, chaque fois qu'il mord dans l'écorce de pastèque s'exclame : "Mon Dieu, je T'en remercie, Tu m'as nourri encore aujourd'hui avec cette écorce de pastèque. Tu as assuré ma subsistance."
En entendant ceci, le Bektashi furieux, se lève et dit : "Arrête, moi j'ai mangé l'intérieur même si c'était amer et de ce fait je ne L'ai pas remercié. Et toi, tu manges l'écorce et tu ne cesses de remercier Dieu pour ce que tu manges. C'est à cause de flatteries de ce genre qu'Il se permet de faire des choses pareilles."
Le livre des derviches bektashi: Villayet name ; suivi de Les dits des Bektashi
; trad. Kurdsi Erguner.